|

SON HISTOIRE
(SUCCINCTE)
JUSQU'EN 1847
-
DE
1851
A
1983 -
JUSQU'A NOS
JOURS
|
 La croix du Languedoc
La croix du Languedoc
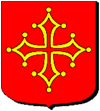 En termes héraldiques, la croix de Toulouse, ou croix du Languedoc ou croix Occitane, est une croix grecque à branches égales rectilignes, « cléchée » et « pommetée » d'or, dont les extrémités sont triplement bouletées et perlées. Elle apparaît avec le sceau de Raymond VI en 1211 et sera toujours utilisée ensuite par le comte de Toulouse. Elle s'imposera dans tout le domaine toulousain au début du XIIIe siècle et figurera, dès lors, les armes de la ville de Toulouse puis celle du Languedoc, du XIVe au XVIIIe siècle. En termes héraldiques, la croix de Toulouse, ou croix du Languedoc ou croix Occitane, est une croix grecque à branches égales rectilignes, « cléchée » et « pommetée » d'or, dont les extrémités sont triplement bouletées et perlées. Elle apparaît avec le sceau de Raymond VI en 1211 et sera toujours utilisée ensuite par le comte de Toulouse. Elle s'imposera dans tout le domaine toulousain au début du XIIIe siècle et figurera, dès lors, les armes de la ville de Toulouse puis celle du Languedoc, du XIVe au XVIIIe siècle.
Plusieurs hypothèses existent sur ses origines qui ont fait l'objet de nombreuses interprétations symboliques. Au début, une simple roue solaire à douze rayons, chacun bouleté à son extrémité, symbolisant les douze maisons du zodiaque (croix de Saint-Michel-de-Lanes dans le Lauragais) Aux XIIe et XIIIe siècles, les clercs voyaient, dans cette figuration, le Christ crucifié entouré de ses douze apôtres. Elle a été également appelée croix cathare dans la mesure où elle s'opposait à la croix latine rejetée par les cathares.
Enfin, elle semble matérialiser l'itinéraire des Wisigoths des rives de la mer Noire à Toulouse par les Balkans, l'Italie et l'Espagne... Il en existe de semblables dans le Midi de la France à Venasque et Forcalquier en Provence, en Catalogne espagnole, cloître de Santa-Maria-de-l'Estany, en Italie du Nord (à Pise et à Venise).
Tombée en désuétude, marquant trop la particularité régionale face au parisianisme triomphant, il faut attendre que Dominique Baudis, d'abord au Conseil Régional puis à la Mairie de Toulouse, réhabilite la Croix du Languedoc et la pose, telle une marque, une enseigne, sur ce qui est fait dans la région (panneaux d'annonces, ouvrages architecturaux, publications régionales etc.)
 Les armes de Toulouse
Les armes de Toulouse
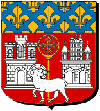 De gueules à la croix cléchée et pommetée de douze pièces d'or, montée sur une hampe du même posée en pal, adextrée* d'un château donjonné de trois tours et senestrée d'une basilique de trois clochers, le tout d'argent maçonné de sable, à l'agneau pascal aussi d'argent, la tête nimbée et contournée, brochant sur le tout ; au chef cousu d'azur semé de fleurs de lys d'or. De gueules à la croix cléchée et pommetée de douze pièces d'or, montée sur une hampe du même posée en pal, adextrée* d'un château donjonné de trois tours et senestrée d'une basilique de trois clochers, le tout d'argent maçonné de sable, à l'agneau pascal aussi d'argent, la tête nimbée et contournée, brochant sur le tout ; au chef cousu d'azur semé de fleurs de lys d'or.
La croix représentée est celle du Languedoc. L'agneau chrétien aurait été à l'origine un bélier. Cet animal, symbole de la force, serait le signe premier de la ville et remonterait à l'époque romaine. Le monument à dextre évoque le Château narbonnais, demeure des comtes de Toulouse, celui à senestre la basilique Saint-Sernin avec les trois tours qu'elle aurait dû avoir.
Le chef de France ancien s'explique par l'héritage du comté de Toulouse au bénéfice de Philippe III le Hardi, roi de France, qui visita la ville en 1272.
*
Dextre : droite. En héraldisme, la droite est celle de celui qui tient l'écusson. Même chose pour la gauche (senestre).
 Pourquoi les Sept Deniers?
Pourquoi les Sept Deniers?
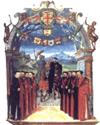 Au Moyen-âge, au nord de Toulouse, sur la rive droite s'étendait une vaste lande (dénommée "pré") dont les Capitouls* avaient accordé à certains toulousains, le droit de pâturage pour leurs bêtes moyennant sept deniers d'or, l'an... Cette lande figure sur les cadastres de 1550, 1571 et 1690 en tant que pré appartenant à la ville de Toulouse. Au Moyen-âge, au nord de Toulouse, sur la rive droite s'étendait une vaste lande (dénommée "pré") dont les Capitouls* avaient accordé à certains toulousains, le droit de pâturage pour leurs bêtes moyennant sept deniers d'or, l'an... Cette lande figure sur les cadastres de 1550, 1571 et 1690 en tant que pré appartenant à la ville de Toulouse.
*
Cette institution composée de riches bourgeois date du comte
Alphonse-Jourdains, fils de Raymond IV. Les capitouls ont administré Toulouse pendant 600 ans,
de 1189 jusqu'à 1789 où ceux-ci ont disparu, comme toutes
les autres institutions locales. Initialement, le capitulum
regroupait quatre juges, deux avocats et six capitulaires
(ancêtres des capitouls), chacun d'eux représentant un
quartier. Ces derniers ont pris peu à peu le pouvoir,
éliminant avocats et juges...

Relativement enclavé, ce quartier a longtemps conservé son côté
agricole, dédié à la violette. C’était aussi un lieu de villégiature
pour la bourgeoisie toulousaine où l’on venait respirer le bon air. Le
quartier s'est constitué autour du hameau des Sept-Deniers apparu au
XVIIIe siècle, principalement habité par des vignerons et des
jardiniers dans des maisons basses et mitoyennes.
La municipalité y avait installé une colonie de vacances. L’implantation
de l’usine JOB et la construction de la cité Madrid ont changé sa
physionomie et le Stade Toulousain attire toujours les foules.
Depuis, le quartier n'a cessé de se développer, passant de 550 habitants
en 1880 à 9000 en 1923... On y trouve l'ambiance d'un quartier qui s'est
constitué au fil du temps avec un paysage urbain entremêlant maisons aux
styles variés et résidences collectives de différentes époques.

|
|
 :
Repère toulousain
:
Repère toulousain |
 :
Historique de quartier
:
Historique de quartier |
_small.jpg) Entourage
bleu = avec
lien Entourage
bleu = avec
lien |
|
|

 Naissance
:
Naissance
:
*
Ils appartiennent à la famille des Celtes et
viennent des bords du Danube. Ils s'installent dans le sud
de la France vers le 4eme siècle avant J.C. et
restent présents jusqu'au 1er siècle avant notre
ère.

 Peste
:
Peste
:
-
1348,
au printemps la
peste noire arrive à Toulouse, la ville est totalement ébranlée.
Cette épidémie fait des ravages jusqu’en 1350, le nombre de décès
est considérable. Bien que non précisément quantifiable on estime 15% à 30% de la population
décimée.
 Recensement
:
Recensement
:

 Le grand incendie
:
Le grand incendie
:
-
7 mai 1463
quartier des Carmes, un incendie parti d'un four mal éteint d'une
boulangerie se propage, attisé par un vent d'autan particulièrement
violent, pendant une douzaine de jours détruisant plus de 7000
habitations. (Nombre de victimes non connu)
Le
couple de boulangers sera gracié par Louis XI et exemptera les
toulousains de la "taille" pour 100 ans. (Exemption levée en
1485 par son fils et successeur Charles VIII)

 Peste
:
Peste
:

 Défilé
:
Défilé
:
*
Charles-Quint reprend
les armes, pour secourir son
allié le duc de Savoie et
prince de Piémont Charles III de Savoie attaqué par
François Ier. Charles de Habsbourg ou Charles
Quint, né le 25 février 1500 à Gand en Belgique et mort
le 25 septembre 1558 au monastère de Yuste en Espagne,
est empereur du saint empire germanique (1519-1555) sous
le nom de Charles V d'Allemagne, roi d'Espagne et de
l’Amérique espagnole sous le nom de Charles Ier
d'Espagne (ou Carlos I), roi de Sicile sous le nom de
Charles IV (1516-1558) et duc de Brabant sous le nom de
Charles II de Brabant (1515-1558).
**
Ce nom est étendu à une vaste surface située le
long de la route de Blagnac, du chemin des Sept-Deniers à la
rue des Troènes.

 La première
fois
:
La première
fois
:

 Peste
:
Peste
:
-
1557, devant l’afflux des pestiférés à l’hôpital
Saint-Sébastien (La Grave), il est décidé de les enfermer
dans les tours des remparts voisins, puis dans le pré des
Sept Deniers et de Bourrassol ou encore sur la colline de
Terre-Cabade.

 Massacre
:
Massacre
:
*
Les querelles
entre catholiques et protestants ouvrent une nouvelle
ère de crise pour la ville. Les réformes luthérienne puis
surtout calviniste trouvent un écho parmi la population
toulousaine. En 1558 est fondé le premier temple protestant
et ceux-ci célèbrent leur culte au grand jour, sans tenir
compte des interdictions royales de Henri II.
Les heurts entre les deux communautés se multiplient :
bagarres et rixes sont quotidiennes dans la ville. Ce sont
alors trente-six années de guerre civile qui commencent,
marquées en premier lieu par les événements de 1572, lors du
trop fameux massacre de la Saint Barthélémy (24 août).

 Peste
:
Peste
:
-
18 mars
1608, nouvelle interdiction de la navigation
entre Bordeaux et Toulouse à cause de la contagion; nouvelles
injonctions aux capitouls et aux consuls de Blagnac... " Cordes Tolosanes, Montech, Escatalens, Saint-Porquier, Castelsarrasy...
et autres lieux riverains de la Garonne; défense de faire aucun
encan public de livres, habits, linge, meubles et ustensiles
pendant les mois de mars et d'avril, l'entrée de la ville de
Toulouse sera interdite aux pauvres étrangers; les capitouls
expulseront ceux qui s'y trouvent en leur donnant quelque aumône
"pour leur passade"; on continuera la garde des portes; il
sera mis des cadenas aux portes des maisons infectées : les
évêques diocésains seront exhortés à faire lire l'arrêt aux
prônes des églises paroissiales et à surveiller l'assistance des
malades; les capitouls feront ouvrir l'hôpital de la peste, où
les malades seront soignés par un ou deux maîtres chirurgiens de
la peste, sous peine de privation de leur maîtrise : défense de
bâtir aucune grange au Pré-des-Sept-Deniers ou ailleurs;"
(Article : AA21/196)
-
1628
à
1632,
la peste
la plus meurtrière (10 000 morts environ)
se déclare à Toulouse,
faute de place à l'hôpital Saint-Sébastien de Saint-Cyprien,
des baraquements en dur ou en bois sont construits à
l'extérieur du rempart. Dans ce camp situé sur le pré des
Sept Deniers, d'environ 72 hectares, on isole et on soigne
les pestiférés dans des conditions précaires. Il devient
rapidement le campement le plus important et progressivement
s'installe une sorte de village (en septembre 1631, 1895
malades sont recensés).

 Recensement
:
Recensement
:

 Inondation
:
Inondation
:

 Peste
:
Peste
:

 Séisme
:
Séisme
:
-
Le 21 juin
1660,
vers trois heures trois quarts du matin, la ville de Lourdes est
partiellement détruite par un tremblement de terre d'intensité
IX (L'épicentre est situé à une vingtaine de kilomètres, dans la
région de Bagnères-de-Bigorre). La secousse se fait ressentir
jusqu'à Toulouse entre autre.

 Autorisation
:
Autorisation
:

 Réalisation
:
Réalisation
:
*
Ce canal "dit Royal" est financé par les États de Languedoc et Riquet lui-même, ancien receveur des Gabelles.

 Inauguration
:
Inauguration
:
*
Henri François d'Aguesseau, seigneur de Fresnes (1668-1751)
finit sa carrière avec le "grade" de chancelier de France,
deuxième grand officier de la couronne dans l'ordre des
préséances. Juriste, il est le symbole et le guide de la
bourgeoisie du XVIIIe siècle.

 Construction
:
Construction
:

 L'espoir
:
L'espoir
:
-
1711,
une petite chapelle dédiée
à la Vierge, située à l'entrée du pré, sert lors de
contagions à faire dire une messe lorsque les personnes sont
frappées de la peste et à faire prier Dieu pour les morts
qui sont enterrés dans le pré.

 Carte
:
Carte
:
-
En
1750


 Petites
histoires
:
Petites
histoires
:
-
1752, Jean de Caulet et
surtout son fils s'emploient à faire décorer la bâtisse que
l'on appelle "le petit Gragnague" (rue des Sports*). Ce charmant immeuble,
entouré d'un parc avec des arbres d'essence rare est vendu à
François Joseph de Porte-Pardailhan, puis à un marchand de
bois : Dominique Roque. Ce domaine sera le théâtre d'une
partie des combats les plus âpres et les plus sanglants de
la bataille de Toulouse en 1814.
*Cet
ensemble en partie défiguré est
actuellement le siège d'une école maternelle et de divers
services.

 Une salle histoire
:
Une salle histoire
:
-
Le 13 octobre
1761
à 22h, un corps est découvert dans la maison familiale Calas
(De confession protestante),
après un dîner en famille pris à l'étage, rue des filatiers.
Les médecins constatent que la cravate du défunt
masque les marques d'une double strangulation.
-
En novembre, le dossier du tribunal ne contient pas de
preuve irréfutable de l’assassinat de Marc-Antoine et aucun
accusé n’a avoué. Le procureur du roi Pimbert décide de
recourir aux monitoires*
en posant quatre questions orientées clairement dans le sens
d’un complot familial à l’encontre du fils pour l’empêcher
de se convertir à la religion catholique. il s'agit là d'une
caricature de la justice d'Ancien Régime. Les capitouls
condamnent le père Jean Calas et son deuxième fils Pierre à
être roués vifs, et Mme Calas à la pendaison, mais cette
sentence est brisée par le parlement.
-
Le 9 mars
1762,
le Parlement condamne Jean Calas à la peine de mort par 8
voix contre 5. Il sera également soumis préalablement à la
question ordinaire et extraordinaire afin qu’il avoue son
crime puisque le dossier est vide. Il est sursis à statuer
sur le cas des autres accusés, les juges attendant les aveux
de Jean Calas.
-
Le 10 mars au matin, le capitoul David de Beaudrigue soumet
le condamné à un dernier interrogatoire. Jean Calas exténué,
ne variera pas et confirmera qu’il est innocent ainsi que
son entourage. Il subit donc la question ordinaire puis
extraordinaire sans rien avouer. L’après-midi, exécution de
Jean Calas place Saint-Georges. Après avoir enduré pendant
deux heures le supplice de la roue, le bourreau l'étrangle
puis jette son corps dans un bûcher ardent et ses cendres
sont dispersées au vent.
Un procès
en réhabilitation
-
Le 7 mars
1763,
le Conseil du roi ordonne à l'unanimité au Parlement de
Toulouse de communiquer la procédure.
-
En novembre, la publication du "Traité sur la tolérance" a
un grand retentissement.
-
Le 4 juin
1764,
une assemblée de quatre-vingt juges casse l’arrêt du
Parlement de Toulouse et ordonne la révision entière du
procès.
-
En février
1765,
le capitoul David de Beaudrigue est destitué.
-
Le 9 mars, Jean Calas et sa famille sont définitivement
réhabilités à l’unanimité par la Chambre des requêtes de
l’hôtel**.Après
avoir passé plusieurs années dans les couvents à fuir la
furie de ceux qui ne voulaient se résoudre à son innocence,
Madame Calas est invitée à Versailles pour rencontrer Louis
XV qui lui accorde, ainsi qu’à ses enfants, une pension de
36 000 livres.
*
Le monitoire à fin de révélations est une procédure
judiciaire de l'Ancien Régime destinée à obtenir des
témoignages supplémentaires lorsque ceux disponibles
s'avèrent inexistants ou non concluants dans le cadre
d'un procès criminel.
**Cour
souveraine composée de maîtres des requêtes, pour juger
les procès entre les officiers de la cour et les causes
que le roi leur renvoie.

 Concours de chevaux
:
Concours de chevaux
:
-
Le 25 juin
1765, des seigneurs anglais, venus savourer les biens faits
de la paix franco-britannique, organisent les premiers
concours de chevaux au pré.

 Un autre canal
:
Un autre canal
:
-
_small.jpg) De
1768
à
1775,
pour favoriser l’accès et se rendre aux ports toulousains
en amont de la Garonne, le Cardinal Loménie de Brienne fait
construire le canal qui porte son nom (dénommé également
canal Saint-Pierre) pour contourner
l’obstacle de la chaussée du Bazacle qui est un frein à la fluidité de
circulation du canal du Midi. De
1768
à
1775,
pour favoriser l’accès et se rendre aux ports toulousains
en amont de la Garonne, le Cardinal Loménie de Brienne fait
construire le canal qui porte son nom (dénommé également
canal Saint-Pierre) pour contourner
l’obstacle de la chaussée du Bazacle qui est un frein à la fluidité de
circulation du canal du Midi.

 Et de un...
:
Et de un...
:

 Carte
:
Carte
:
-
En
1772


 Et de deux...
:
Et de deux...
:
*Urbaniste et directeur
des travaux public du Languedoc pour la sénéchaussée de
Toulouse.

 Inauguration
:
Inauguration
:
*Le sculpteur François
Lucas
(1736-1813) était professeur à l'académie royale de peinture,
sculpture et architecture de Toulouse à partir de 1764. En
1784, il succéda à A. Rivalz comme dessinateur de l'académie
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Il
était le fils du sculpteur Pierre Lucas et frère de
Jean-Paul Lucas, premier conservateur du musée des
Augustins.

 Jurisprudence administrative
:
Jurisprudence administrative
:
-
Le 13 mai
1783, attributions municipale. " Resp Pf pl B 0117/33. Ordonnance de Messieurs les Capitouls, portant
défenses à tous tombelliers, ou charretiers, de tirer du sable, du gravier, ou des cailloux des bords de la
Garonne, le long du pré des Sept Deniers, sous les peines y contenues. Du 13 mai 1783. – [Toulouse] :
s.n., [1783]. – 4 p. : bandeau aux armes gr.s.b.; 4° ".

 Sans
influence
:
Sans
influence
:
*Ces événements parisiens de
juin-juillet sont connus à Toulouse grâce à deux journaux
toulousains : les Affiches (créé en 1759) et le nouveau Journal de
Toulouse. Il convient d'ajouter à ceux-ci le Bulletin des États
Généraux de Mirabeau1, que l'on peut se procurer aisément
dans la ville. A compter du 20 juillet, les nouvelles de
l'insurrection de Paris se répandent dans le Midi Toulousain mais ce
n'est que le 27 juillet que l'insurrection gagne Toulouse proprement
dite. Un groupe de pauvres et de mendiants s'est constitué et armé
dans les faubourgs de Saint Cyprien, quartier le plus pauvre de la
ville, pour aller prendre le couvent des Grands Augustins, où le blé
était stocké. Ainsi, comme à Paris, la contestation politique
est couplée à la contestation économique.
1 Honoré Gabriel Riqueti comte de, homme politique et orateur
prestigieux 1749-1791.
 Recensement
:
Recensement
:
 Fin
de règne
:
Fin
de règne
:
*Les Capitouls du parlement restent en
place, mais doivent ouvrir le nouveau conseil de ville à de petits
bourgeois, commerçants ou à des artisans. Toulouse fait figure
d'exception puisqu'au contraire de la très large majorité des
villes, elle conserve une composante monarchiste au sein du
conseil de ville. Cependant, le maintien du parlement de la ville
n'est que temporaire puisque celui-ci est définitivement supprimé en
décembre 1789, et ce sans contestation de la population.

 Une
autre
ère
:
Une
autre
ère
:
-
28 février
1790, la nouvelle municipalité*
est solennellement installée au Capitole, elle est composée de cinquante quatre membres.
Cela fait suite à la loi municipale du 14 décembre 1789 qui crée un
conseil général de la commune élu pour deux ans par les citoyens
actifs.
*Son maire (premier de Toulouse jusqu'au 1er août 1792) élu est un professeur à la faculté de droit, Mr Joseph de Rigaud.

 Bataille
:
Bataille
:
-
Le 10 avril
1814, se
déroule dans
les alentours des Ponts Jumeaux de très violents combats lors de la bataille* de
Toulouse. Les Anglo-Portugais veulent franchir le canal dans
les parages, celui-ci forme une barrière et des palissades
sont "montées" afin de le renforcer. 350 braves
grognards et leurs cinq canons s'y défendent tant bien que mal
face aux assauts de l'armée de Wellington. Les assaillants sont
repoussés plusieurs fois dans la journée et ne pourront
dépasser cet obstacle.

*La bataille de Toulouse,
Joseph Bonaparte, roi déchu d'Espagne, en fuite, est poursuivit par
Wellington et les troupes espagnoles. Une bataille dont on ignore la légitimité
puisque Napoléon a abdiqué et que tout le monde connaît la
nouvelle jusqu'au
champs de bataille. Face aux troupes du
maréchal
Soult qui couvre la retraite du roi, se
trouvent les troupes espagnoles, portugaises, écossaises, anglaises,
irlandaises, galloises et allemandes des coalisés. L'armée
de Wellington compte plus de 50.000 hommes. Soult a plus de 30.000 hommes à sa charge et
établi son camp au sommet de la colline du Calvinet, (actuellement
Jolimont) il édifie des
redoutes.
La bataille a lieu, les
toulousains qui n'ont plus jamais connu de guerre depuis la croisade
des albigeois se précipitent à leur fenêtre afin d'assister aux
épreuves de force, certains sont tués, une balle perdue les ayant
atteint.
A Saint-Cyprien, les anglais sont
repoussés, aux Ponts Jumeaux, les écossais et les espagnols tombent. Soult abandonne les redoutes de Jolimont
et se replie vers les abords du canal du midi. Le 11 avril, il évacue ses troupes en
direction de Castanet, il abandonne Toulouse. Wellington entre en
triomphe à Toulouse, la foule, à tendance royaliste
accourt auprès de leur libérateur.
Dans cette
interminable bataille surnommée "Pâques rouges", 975
soldats perdent la vie dans un combat qui dura près de
10h et il y a 7956 blessés.
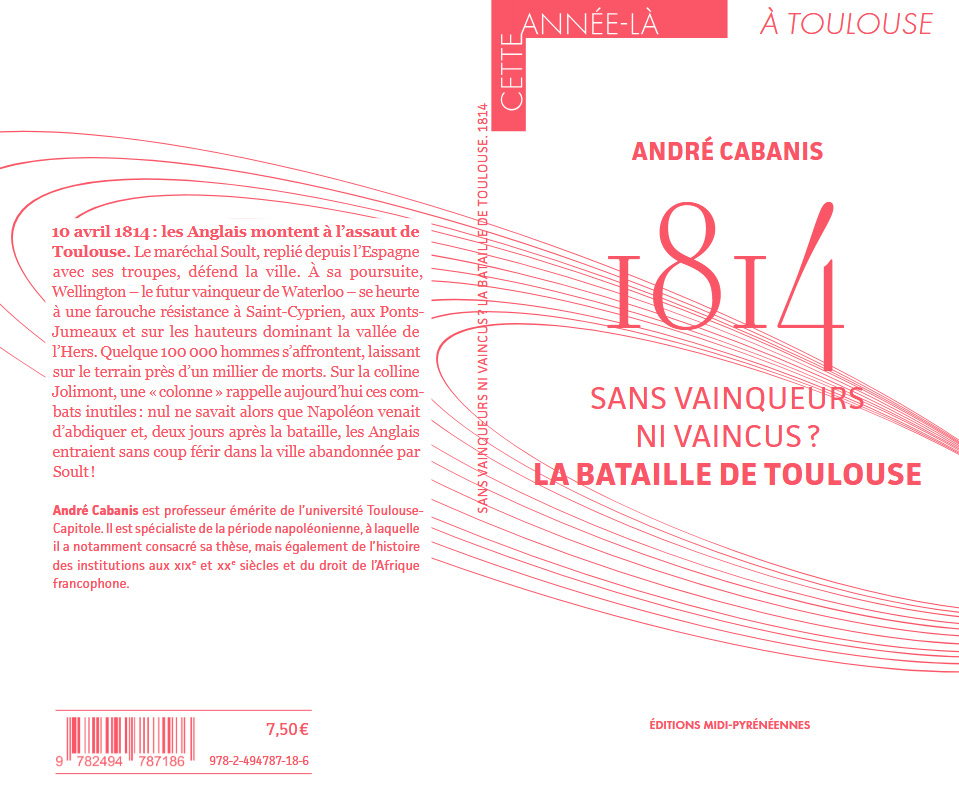 Pour un complément
d'information sur cet événement historique, un livre est publié
dans la collection "Cette année-là" : Pour un complément
d'information sur cet événement historique, un livre est publié
dans la collection "Cette année-là" :
"1814. Sans vainqueurs, ni vaincus, la bataille de Toulouse".
Ouvrage dont voici des extraits : https://www.calameo.com/read/0057890516ed456c4d2a3
(En
aparté : Inauguration d'une statue d'un soldat de napoléon en février
2025)

 Carte
:
Carte
:
-
En
1815
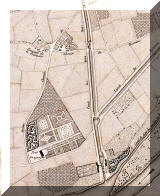
-
En
1825
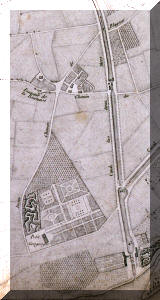

 Épidémie
:
Épidémie
:

 Pour éviter la Garonne
:
Pour éviter la Garonne
:

*L'ingénieur
Jean-Baptiste de Baudre
(1773-1850)
aménagea les ports de Calais, de Bordeaux, le canal de
Garonne et les fleuves Adour et Garonne. Il ne voit cependant
pas l’achèvement du canal de Garonne dont la monarchie
de juillet avait d’ailleurs interrompu les travaux en
aval d’Agen. Ils n’ont repris qu’en 1846. Dans le cadre
d’une mesure générale d’allègement et de renouvellement
des personnels de l’administration, le gouvernement de
la république le met en retraite en 1848 avec le grade
d’inspecteur général honoraire.

 Construction
:
Construction
:
-
 Le
27 avril
1841, par
suite de l'autorisation publiée par ordonnance royale, le pont
suspendu est établi sur la Garonne en remplacement du bac
existant, en face de Blagnac.
Ce pont n'a pas de pile en rivière, il est d'une seule volée de 140
mètres. Ouvert au public le 28 avril 1844, il a été construit par
les architectes Marnac et Quénot.
J.Quenot, ingénieur civil à Paris est concessionnaire du pont
jusqu'en 1878. Le
27 avril
1841, par
suite de l'autorisation publiée par ordonnance royale, le pont
suspendu est établi sur la Garonne en remplacement du bac
existant, en face de Blagnac.
Ce pont n'a pas de pile en rivière, il est d'une seule volée de 140
mètres. Ouvert au public le 28 avril 1844, il a été construit par
les architectes Marnac et Quénot.
J.Quenot, ingénieur civil à Paris est concessionnaire du pont
jusqu'en 1878.

 Carte
:
Carte
:
-
En
1847
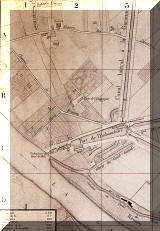
|

JUSQU'EN 1847
-
DE
1851
A
1983 -
JUSQU'A NOS
JOURS
|